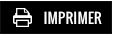Rana Plaza 8 ans déjà : un bilan de l’industrie de la mode
Les violations persistent mais nous avons les moyens d’agir
L’industrie textile pèse aujourd’hui 3000 milliards de dollars. Plus de 100 milliards de vêtements sont produits chaque année dans le monde, et cela représente plusieurs dizaines de millions de tonnes. Derrière ces chiffres faramineux se cachent des inégalités de grande ampleur et des situations de violation des droits humains, qui touchent de plein fouet les travailleurs·ses de l’industrie de la mode. Alors que l’effondrement du Rana Plaza, le 24 avril 2013, avait provoqué un choc de conscience, dans les médias et auprès du public, qu’en est-il aujourd’hui ? Quelles sont les conditions de travail et de vie des personnes, majoritairement des femmes, qui travaillent au sein de la chaîne de production de cette fast fashion ?
Nous faisons le point, en partenariat avec Oxfam.
La fast fashion, pourvoyeuse de pauvreté
Les organisations et les citoyen·ne·s sonnent l’alerte
Depuis de trop nombreuses années, les organisations de défense des droits humains au travail documentent les violations systémiques des droits des travailleurs·ses liées au modèle de production dans l’industrie de l’habillement. La pression sur les coûts et les délais de production, dans le but d’accroître les profits, pèse avant tout sur les ouvriers et les ouvrières au bout de la chaîne, qui en paient le prix fort. La Clean Clothes campaign ou le Collectif Ethique sur l’étiquette en France, dont Oxfam France est un membre fondateur, publient régulièrement informations et rapports, relaient les luttes des ouvrier·e·s du secteur et appellent à la mobilisation citoyenne.
La campagne « What She Makes », lancée en 2017 par Oxfam Australie, a permis la sortie de plusieurs rapports qui montrent que l’industrie de la mode enferme les femmes et les hommes qui y travaillent dans une spirale de la pauvreté. En 2019, le rapport « Made in Poverty » a notamment mis en lumière les inégalités criantes vécues par les travailleurs·ses du textile au Bangladesh et au Vietnam.
Au Bangladesh, pauvreté et violations des droits dans les usines textiles
La situation est particulièrement critique au Bangladesh, où s’est produit l’effondrement du Rana Plaza en avril 2013. Les chiffres du rapport d’Oxfam Australie sont effarants. Parmi l’échantillon de personnes interrogée dans ce pays, 9 ouvrier·e·s sur 10 déclarent que leurs revenus ne permettent pas de subvenir aux besoins essentiels de leur foyer. Une grande majorité d’entre eux fait régulièrement des heures supplémentaires (99% au Bangladesh, 65% au Vietnam), et ces conditions de travail précaires ne leur permettent pas de manger à leur faim, de vivre dans un logement décent ou encore de couvrir les frais de scolarité de leurs enfants. De plus, la peur de perdre son emploi est très forte dans ce secteur. D’ailleurs, aucun·e des répondant·e·s bengladais·es ne souhaite que leurs enfants travaillent dans une usine textile un jour.
Le Collectif Ethique sur l’Etiquette (ESE) a établi un bilan de la situation dans ce pays. Si des avancées ont eu lieu dans les mois qui ont suivi le drame du Rana Plaza, le pays est resté l’eldorado des enseignes qui veulent produire à bas coût. La main d’œuvre bangladaise voit son salaire stagner autour de 80 euros mensuels. Les syndicats en demandent immédiatement le double ; il faudrait au moins le triple de cette somme pour atteindre un niveau de salaire vital. La répression syndicale demeure le quotidien des ouvrières et des ouvriers qui défendent leur droit à une augmentation de salaires. En 2019 des mouvements de protestation ont suscité des tirs à balle réelles de la police et sont soldées par des centaines d’arrestations arbitraires, de blessés et même un mort.
Une précarité mise en lumière et accentuée par la pandémie de COVID-19
Au-delà du Bangladesh, la pandémie de Covid-19 a révélé la vulnérabilité des travailleuses et des travailleurs du secteur dans le monde. Entre licenciements massifs et coupes de salaires en raison de la chute des ventes d’habillement, pour les seuls 3 premiers mois de la pandémie, ce sont entre 2,7 et 4,9 milliards d’euros de salaires impayés qui leur sont dus, d’après le rapport Underpaid in Pandemics de la Clean Clothes Campaign.
Le témoignage de Chameli : la parole d’une femme qui illustre les conditions de vie de millions d’autres ouvrières du textile
©Fabeha Monir/ OxfamAUSLe rapport d’Oxfam « Made in Poverty », paru en 2019, présente le témoignage d’une ouvrière du textile d’Asie du Sud-Est, Chameli. Elle travaille dans une usine au Bangladesh, qui fabrique des vêtements pour une chaîne de magasins australiens. En moyenne, son salaire mensuel est de 128 AUD, soit un peu plus de 80 euros. Il lui arrive très fréquemment de faire des heures supplémentaires, parfois jusqu’à 3 heures du matin et cela au moins une fois par semaine. Avec ces heures en plus, elle gagne au maximum un peu plus de 100€ par mois. Son salaire moyen est d’environ 0.33€ par heure. Selon Asia Floor Wage, le salaire vital au Bangladesh est de 368€ (chiffres 2017).
Sa famille est criblée de dettes ; elle a perdu son fils, et son mari a souffert d’importants problèmes de santé. Chameli n’a pas les moyens d’envoyer ses trois filles à l’école : elle a donc pris la difficile décision d’envoyer sa plus grande fille, âgée de 14 ans, travailler dans une usine de vêtements. Cette histoire n’est pas isolée : c’est le quotidien d’un nombre colossal de femmes ouvrières de l’industrie textile à travers le monde.
Tel est l’envers du décor de la mode : des situations de grande précarité vécues par des millions de travailleur·euse·s de l’industrie du vêtement. Ces inégalités sont perpétuées par tout un modèle économique.
Un modèle économique responsable de fortes inégalités et de violations des droits humains
La confection d’un vêtement nécessite de nombreuses étapes, dans lesquelles sont impliqués une myriade d’entreprises et d’individus : marques, détaillants, fabricants, sous-traitants. Tout au long de ce processus – qui, malgré sa complexité, peut être réduit à 30 jours pour la fast-fashion – les inégalités et violations des droits humains se multiplient.
Le partage des richesses sur les ventes de vêtements : des inégalités criantes
Sur le prix de vente d’un t-shirt à 29€, 68% sont dédiés à la marge de la marque et du magasin. La marge de l’usine au Bangladesh, elle, est de 4%. Le salaire de l’ouvrier·e ne représente que 0.6% de ce prix final. Cela montre à quel point les étapes de conception et de distribution concentrent la majorité des richesses. Pourtant, les étapes de culture, filature, tissage, ennoblissement, et confection sont souvent complexes, pénibles, et en première ligne des dangers sanitaires et sociaux. Ces postes sont peu rémunérateurs et considérés comme « à faible valeur ajoutée » par les marques et détaillants, loin des sommes faramineuses accumulées par les multinationales du secteur.
Zara passée à la loupe d’Ethique sur l’étiquette et Public Eye
Dans le rapport « Le coût du RESPECT selon Zara », le Collectif Ethique sur l’étiquette et Public Eye ont décomposé, au réel, la valeur d’un sweatshirt Zara confectionné en Turquie. En remontant toute la chaîne de fabrication étape par étape et pays par pays, de la culture du coton en Inde à l‘impression du slogan en Turquie, ce rapport montre la capacité de l’enseigne à capter l’essentiel des bénéfices tout au long de la chaîne, au détriment de ses fournisseurs et surtout de la main d’œuvre. Selon le rapport, il faudrait au moins doubler la rémunération des ouvrières et des ouvriers qui interviennent à toutes les étapes de fabrication pour que la répartition soit juste. Et Zara, dont le modèle économique est un des plus rentables, a largement les moyens d’absorber ce coût.
Cette analyse menée par Le Basiq pour Ethique sur l’Etiquette et Public Eye, montre que ce système est fondé sur un modèle économique bien précis, centré autour de maximisation des profits. Il s’agit d’un modèle ultra performant, qui fonctionne grâce à une organisation « verticale », qui intègre un grand nombre d’étapes et permet de répondre extrêmement rapidement à la demande. C’est ce système qui permet à l’enseigne de faire évoluer chaque semaine ses collections, et de proposer des produits éphémères, vendues en quantité limitée sur une courte période, afin de limiter le risque stock et la part de vêtements en solde.
Ensuite, ce modèle est inspiré du lean management : la recherche de rentabilité est au centre du processus et permet de capter la très grande majorité des bénéfices générés par les différents acteurs de la chaîne. Ce rapport met clairement en lumière que ce modèle ne tient pas compte de la juste rémunération des travailleurs·ses du secteur, car les salaires qui leur sont versés sont largement inférieurs au niveau de salaire vital des pays concernés.
– Pour aller plus loin : Fast fashion versus slow fashion : de quoi parle-t-on ?
Devoir de vigilance des multinationales : 8 ans après le drame du Rana Plaza, où en est-on ?
Ce qu’a montré le drame du Rana Plaza, c’est l’impunité dont bénéficient les multinationales dans la mondialisation, jusque-là non responsables juridiquement des impacts sociaux et environnementaux que cause leur activité à l’international. La loi sur le devoir de vigilance est venue ébrécher cette impunité.
Le devoir de vigilance, qu’est-ce que c’est ?
Adoptée en mars 2017 après 5 ans de mobilisation, portée par une coalition inédite d’ONG, de syndicats, de parlementaires, de juristes et d’autres experts, cette loi pionnière marque une avancée historique : elle exige des grandes multinationales françaises ou présentes en France qu’elles publient et mettent en œuvre un plan de vigilance, permettant d’identifier et de prévenir les risques d’atteintes aux droits humains et à l’environnement que peut causer leur activité, mais également celle de leurs filiales et de leurs sous-traitants et fournisseurs, en France comme à l’étranger. Il sera possible d’engager la responsabilité civile de l’entreprise en cas de manquement à ces nouvelles obligations.
Le texte ouvre ainsi de nouvelles possibilités pour les victimes d’accéder à la justice et d’obtenir réparation, même si cette dernière étape demeure un parcours du combattant.
Quelle application du devoir de vigilance en France ?
Toutefois, dépourvue d’un système de contrôle, elle est mal appliquée en France, et l’Etat ne joue pas son rôle pour s’assurer de sa mise en œuvre. C’est aujourd’hui aux ONG et aux syndicats de s’assurer de la publication, du contenu et de la mise en œuvre de la loi, même si elles continuent d’exiger du gouvernement français une amélioration du texte et de sa mise en œuvre.
L’adoption du devoir de vigilance au niveau européen : un enjeu clé
Mais elle a permis d’engager un mouvement pour des législations similaires dans plusieurs pays d’Europe et arrive désormais au niveau européen. C’est là que se situent les enjeux aujourd’hui. Poussé par des dizaines d’organisations de la société civile européenne, le Commissaire à la justice Didier Reynders s’est engagé à ce que la Commission européenne adopte une directive européenne sur le devoir de vigilance.
Une première étape importante a déjà été franchie le 10 mars dernier avec l’adoption du rapport d’initiative parlementaire recommandant d’instaurer une telle législation. C’est désormais à la Commission européenne et au Conseil d’élaborer une directive suffisamment ambitieuse, instaurant un réel mécanisme de responsabilité et un accès des victimes à la justice, afin qu’elle protège réellement les droits fondamentaux et ne laisse pas les violations impunies.
– Pour aller plus loin, lire la lettre ouverte : Multinationales : le temps de la responsabilité
Des changements nécessaires au sein de la gouvernance des multinationales
Pour Oxfam, le devoir de vigilance doit aussi s’accompagner de changements dans la gouvernance des entreprises, qui ne peuvent plus seulement prioriser leurs actionnaires, mais également s’assurer que leur action s’inscrit dans une logique de prise en compte de la planète, des salarié·e·s, de leurs fournisseurs et sous-traitants tout au long de leur chaîne de valeur.
Cela peut nécessiter des investissements conséquents, ou un réajustement des conditions contractuelles avec les sous-traitants, afin de s’assurer qu’en bout de chaine, les travailleurs·ses puissent vivre décemment. Les versements aux actionnaires devront être moins priorisés, et de manière globale, les entreprises devront s’assurer que leur stratégie comporte un volet sur les salaires décents à tous les niveaux de la chaîne de valeur.
La gouvernance est également au menu de la directive européenne à venir : l’occasion d’adopter des mesures ambitieuses pour un changement radical vers un modèle d’entreprise plus juste.
Une autre mode est possible : notre consommation a du pouvoir, et nous avons le pouvoir citoyen !
Le pouvoir citoyen pour changer le système en profondeur
Pour changer ce modèle prédateur, pour faire avancer les lois et la responsabilité des multinationales, la pression citoyenne est notre meilleure arme. Il faut certes repenser nos modes de consommation, consommer moins et mieux, privilégier la seconde main, les vêtements recyclés ou up-cyclés et se diriger lorsque cela est possible vers des marques responsables. Mais lorsque le consommateur n’a pas le choix de l’offre, il a la liberté de la mobilisation citoyenne.
Alertes multiples sur les conditions de travail aux quatre coins du monde, adoption de la loi sur le devoir de vigilance, évolution en matière de transparence des enseignes : ces avancées sont obtenues grâce aux milliers de citoyennes et de citoyens qui, à nos côtés, signent les pétitions, écrivent aux décideurs politiques, les interpellent sur les réseaux sociaux, et manifestent ainsi auprès de ceux qui nous gouvernent leur refus d’être complices des mauvaises pratiques des multinationales. Ce soutien est essentiel pour appuyer nos revendications et celles des organisations de défense des droits des travailleuses et des travailleurs.
Lors de temps forts comme celui de la commémoration de l’effondrement du Rana Plaza, le Collectif Ethique sur l’étiquette et Oxfam France se mobilisent avec des mouvements comme Fashion Revolution France pour accroître la pression sur les marques et enseignes de mode. Elle rassemble un grand nombre d’acteurs autour d’une semaine thématique rythmée par des conférences, webinaires, et évènements en tous genres, dont la conférence « Droits et Plaidoyer », où l’historienne et chercheuse Audrey Millet, Nayla Ajaltouni d’Ethique sur l’étiquette et Manon Duval d’Oxfam France ont pu échanger autour des inégalités, des violations de droits dans l’industrie textile et les avancées de la loi sur les agissements des multinationales.
Donnons un sens à nos achats
Le pouvoir citoyen peut s’exprimer jusque dans les choix de consommation. De nombreuses alternatives à la fast-fashion existent. L’idéal est de privilégier des marques ou enseignes qui offrent une grande transparence sur leur chaîne de production, travaillent avec des matières respectueuses de l’environnement, font appel à des acteurs dont les conditions de travail ne portent pas atteinte aux droits humains. Nos achats de mode peuvent avoir un lourd bilan environnemental et social, et nous avons le pouvoir de changer cela, en refusant les situations d’inégalités et de violation des droits humains au travail, grâce à des choix alternatifs de consommation.
La seconde main est l’une de ces alternatives : elle permet de défendre un modèle plus durable et responsable. Plus d’un millier de magasins solidaires Oxfam offrent cette possibilité à travers le monde. En France, les six bouquineries et friperies de l’association proposent des livres et des vêtements de seconde main, à Lille, Paris et Strasbourg. La vente de ces articles finance les actions de plaidoyer, de mobilisation et de terrain d’Oxfam, à un niveau français et international
L’industrie de la mode est responsable d’innombrables inégalités et de violations des droits humains au travail. Face aux écarts de richesses indécents et au non-respect de la dignité des travailleurs·ses du secteur, nous devons agir : en tant que citoyen·ne grâce à l’information et à la mobilisation, en tant que consommateur·rice en achetant moins et mieux. Huit ans après le drame du Rana Plaza, l’évolution de la législation grâce à la future directive européenne sur le devoir de vigilance, la forte mobilisation des citoyen·ne ·s et les alternatives de consommation existantes nous permettent de croire qu’une révolution de la mode est bel et bien possible.